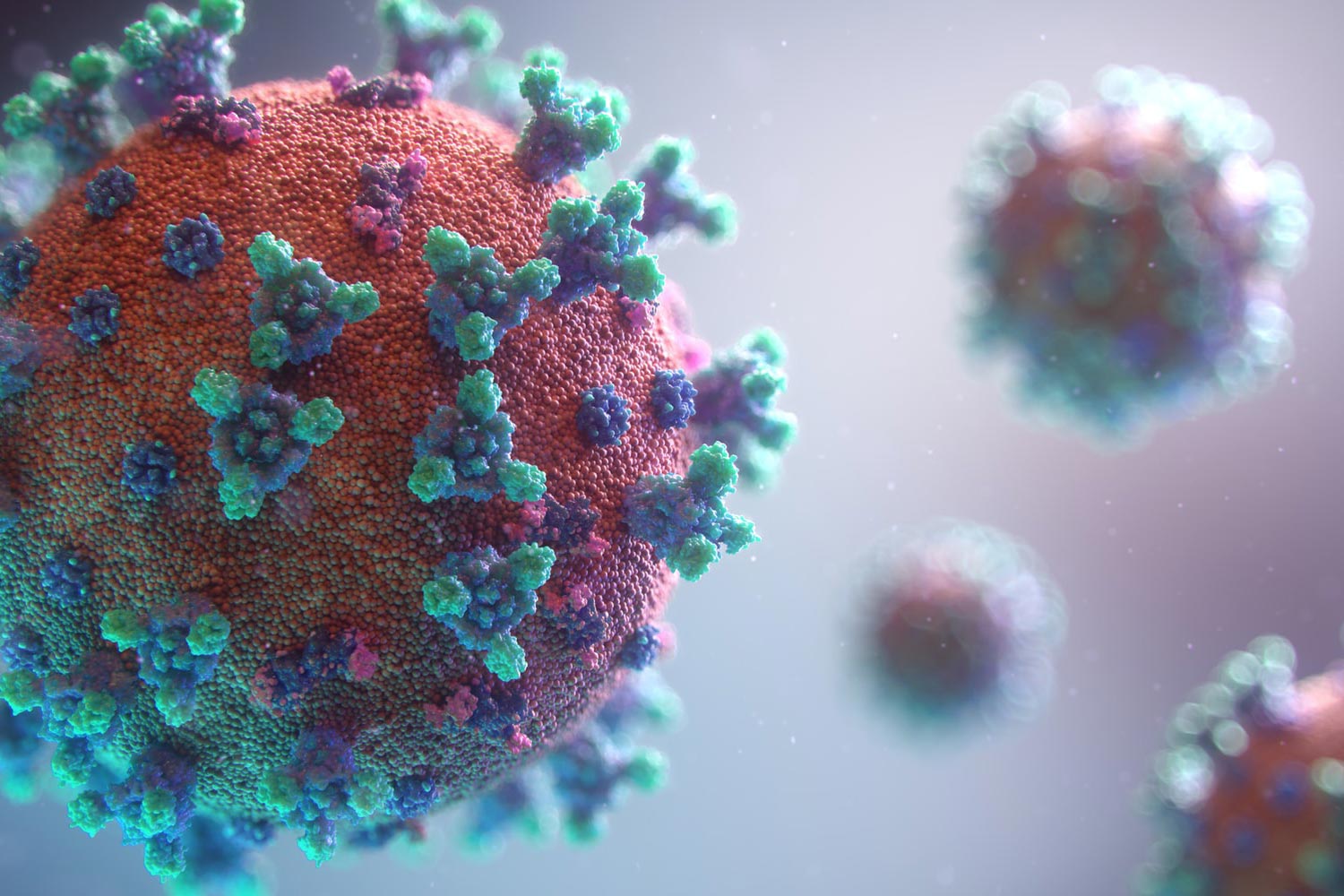L’IMPORTANCE DE L’ENTRETIEN ANNUEL DANS LE CADRE DU FORFAIT JOURS
Un important arrêt de la Chambre sociale en date du 12 mars apporte de nouvelles précisions sur le régime des conventions de forfait en jours.
Le premier concerne la tenue d’un entretien annuel individuel, prévu à l’article L. 3121-46 C.trav. Celui-ci doit porter sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale du salarié ainsi que sur la rémunération. Issue de la loi du 20 août 2008, la question s’est posée de savoir si cette disposition était applicable aux conventions de forfait conclues avant l’entrée en vigueur de la loi. En l’espèce, le salarié avait été embauché en 2006 en qualité de cadre soumis à une convention de forfait en jours et son employeur ne l’avait jamais convoqué à un tel entretien. Pour se défendre, l’employeur invoquait la non-rétroactivité de la loi (article 2 du Code civil), mais l’argument n’a pas suffi à la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l’article L. 3121-46 sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d’exécution lors de son entrée en vigueur. En effet il n’était pas question de rendre cette disposition rétroactive mais simplement d’application immédiate, y compris aux conventions conclues antérieurement. Il en résulte que l’employeur n’était pas dispensé d’organiser l’entretien annuel.
Les conséquences sont lourdes car la Cour de cassation sanctionne le défaut d’entretien annuel par l’inopposabilité de la convention de forfait au salarié. La convention n’ayant plus d’effet, le décompte de la durée du travail doit se faire selon le droit commun et le salarié peut donc demander un rappel d’heures supplémentaires.
Cette décision s’inscrit dans une même construction jurisprudentielle privant d’effet toute convention de forfait dont les conditions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables.
Reste donc au salarié à rapporter la preuve de la réalisation de ses heures supplémentaires, en l’occurrence au moyen d’un décompte qu’il aura produit ou des heures indiquées sur les courriels afin de conforter son décompte. En général, la jurisprudence admet pour ce type de litige tous types d’éléments relativement précis quant aux horaires effectués. Conformément à l’article L. 3171-4, la Cour de cassation rappelle que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires est partagée entre l’employeur et le salarié, celui-ci ne pouvant l’assumer seul. A défaut d’éléments fournis par l’employeur, le juge formera sa conviction sur la base des éléments apportés par le salarié.
Enfin, l’arrêt revient sur la nécessité pour la convention individuelle de forfait de prévoir le nombre exact de jours travaillés. En effet, si un accord collectif doit déterminer le nombre maximum de jours travaillés sur l’année, il revient à la convention individuelle de forfait de fixer le nombre de jours travaillés pour chaque salarié. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, la convention individuelle se contentait d’indiquer une fourchette de 215 à 218 jours en raison de l’impossibilité de déterminer de façon intangible le nombre maximum de jours travaillés chaque année du fait des variables liées au calendrier. L’argument ne convainc pas la plus haute juridiction qui invalide la convention de forfait et considère qu’une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés.
Soc. 12 mars 2014 n°12-29-141
LE SUICIDE HORS DES TEMPS ET LIEU DE TRAVAIL PEUT ETRE RECONNU COMME ACCIDENT DU TRAVAIL
Alors que les suicides se multiplient dans certains groupes ces dernières années, la Cour d’appel de Chambéry a rendu une décision reconnaissant le caractère professionnel du suicide d’un salarié placé en chômage technique.
Cette décision admet l’origine professionnelle du suicide d’un salarié en dehors de son lieu de travail, en raison de sa crainte de perdre son emploi.
Le Code de la Sécurité Sociale (article L. 411-1) considère « comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ». Le caractère professionnel de l’accident (ou du suicide) suppose donc un lien direct entre ce dernier et le travail.
Ainsi, est un accident du travail celui survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur.
Pour sa reconnaissance, la jurisprudence en a déduit que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail et pose donc une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors qu’il intervient sur les lieux et temps de travail.
C’est alors à l’employeur qui conteste la qualification d’accident du travail de renverser cette présomption en démontrant que l’accident est sans lien avec l’activité professionnelle.
Lorsque le suicide ou sa tentative survient hors des lieu et temps de travail, il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail. Dans ce cas, l’accident du travail ne sera reconnu que si la victime (ou ses ayants droits) démontre l’existence d’un lien de causalité avec l’activité professionnelle.
Dans l’affaire en cause, le salarié avait été placé -une nouvelle fois – en chômage technique et un courrier d’adieu expliquait sa crainte d’un licenciement, la perte de l’estime de soi et son sentiment de dévalorisation personnelle et professionnelle.
Plusieurs salariés étaient d’ailleurs dans la même situation de détresse selon les médecins du travail pour qui les salariés avaient été laissés sans soutien par leur hiérarchie. Son suicide, commis à son domicile, est reconnu comme accident du travail par les juges en raison de ses liens avec le travail : dans la mesure ou le suicide s’avère objectivement perpétré comme un acte indissociablement lié à sa relation de travail, il doit être admis que ce décès a une origine professionnelle: la qualification d’accident du travail doit donc être retenue.
Alors que la loi sur l’indemnisation des accidents du travail a bientôt 116 ans, l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur ne cesse de s’étendre sur le fondement de l’article L. 4121-1 du Code du travail selon lequel l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le domaine de l’obligation de sécurité de l’employeur s’est d’abord étendu de la santé
physique à la santé mentale du salarié pour ensuite être sollicitée à l’extérieur de l’entreprise.
Depuis un arrêt de 20074 est reconnu le caractère d’accident du travail de la tentative de suicide survenue à domicile mais « par le fait du travail »,en l’occurrence celle-ci faisait suite à un harcèlement moral.
Cour d’appel de Chambéry, 11 mars 2014 n°13/01162
CHSCT : LA CONDITION D’EFFECTIF S’APPRECIE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE
Un CHSCT est constitué dans tout établissement d’au moins cinquante salariés d’après l’article L. 4611-1 du Code du travail.
Prenant cet article au pied de la lettre, une entreprise qui emploie environ 1 000 salariés avait décidé de ne mettre en place un CHSCT que dans le seul de ses établissements atteignant les 50 salariés, laissant ainsi non couverts les salariés
des autres établissements (40 magasins ne dépassant jamais les 49 salariés).
Dans son arrêt du 19 février 2014, la Chambre sociale condamne cette lecture restrictive et considère que dans cette configuration, c’est au niveau de l’entreprise, appréciée dans son ensemble, que doit être mis en place un CHSCT :
tout salarié employé par une entreprise dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d’un CHSCT.
La CFTC Cadres salue cette interprétation qui rend impossible le morcellement de l’entreprise en plusieurs établissements afin d’échapper à la mise en places d’instances de représentation du personnel.
Soc. 19 février 2014 n° 13-12.207
4 Civ. 2ème 22 février 2007 n° 05-13.771
PRISE D’ACTE DU SALARIE PROTEGE : UNE PARTICULARITE DANS SON INDEMNISATION
Un délégué du personnel avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur suite notamment à des faits de harcèlement moral et de menaces de mort ayant fait l’objet de condamnations pénales. Sa prise d’acte étant justifiée, elle produisait les effets d’un licenciement nul car prononcé en violation du statut protecteur du salarié.
En cas de licenciement portant atteinte à une liberté fondamentale (en l’occurrence la liberté syndicale), le salarié bénéficie d’un choix entre la réintégration dans l’entreprise ou une indemnité spécifique. Cependant, lorsque la rupture résulte d’une prise d’acte, la jurisprudence considère qu’elle ne peut donner lieu à réintégration.
Ainsi, c’est sur le plan indemnitaire que le délégué du personnel avait dû se placer pour obtenir réparation de son préjudice : outre les habituelles indemnités de rupture et l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il demandait à son employeur le paiement d’une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur.
La Cour de cassation donne droit au salarié, considérant que la prise d’acte était justifiée et produisait les effets d’un licenciement nul, en sorte qu’elle ouvrait droit, au titre de la violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours. L’arrêt opère une précision importante en mentionnant non pas la fin du mandat mais la fin de la période de protection, laquelle s’étend aux 6 mois suivant l’expiration du mandat de délégué du personnel.
Soc. 12 mars 2014 n° 12-20.108
Soc. 29 mai 2013 n° 12-15.974
Art. L. 2411-5 C. trav. pour les délégués du personnel et art. L. 2411-3 pour les délégués syndicaux dont la protection est étendue à 12 mois suivant la date de cessation des fonctions
ELECTIONS PROFESSIONNELLES : LISTE COMMUNE ET DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX,ATTENTION DANGER !
Il ressort d’une décision de la Cour de cassation en date du 14 janvier 2014, que les syndicats n’ayant pas obtenu chacun plus de 10% des suffrages dans le cadre d’une liste commune ne peuvent pas désigner de délégué syndical.
En l’espèce la CFTC, FO, et la CGT avaient présenté une liste commune au premier tour des élections professionnelles. La liste commune a obtenu 16% des suffrages, mais aucun des syndicats n’atteignaient les 10% de suffrages une fois la clef de répartition appliquée (6,59% pour la CGT et FO et 2,89% pour la CFTC).
Les trois syndicats s’étaient donc mis d’accord pour s’entendre et désigner un délégué syndical commun en se fondant sur le score obtenu par la liste commune. En effet, il serait logique que les organisations syndicales qui ont présenté une liste commune ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés puisse désigner un délégué syndical commun, peu important le score obtenu par chacune d’entre elles.
La Cour de cassation n’a malheureusement pas été de cet avis puisqu’elle fait une application stricte de l’article L. 2143-3 (Chaque organisation syndicale représentative [donc ayant obtenu plus de 10% des suffrages aux élections] dans l’entreprise ou l’établissement de plus de 50 salariés ou plus […] désigne […] un ou plusieurs délégués syndicaux). Elle considère ainsi qu’ayant constaté qu’aucune des organisations syndicales concernées n’avait recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune.
Il en résulte que dans le cadre d’une liste commune, seuls les syndicats ayant dépassé les 10% de voix peuvent désigner un délégué syndical. Ce n’est donc pas la liste commune qui doit justifier de 10 % des voix mais bien chaque syndicat, pris individuellement, désirant désigner un délégué syndical.
Cass. Soc. 14 janvier 2014 n°12-289.